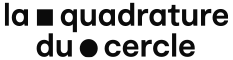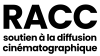Chaque saison.
Un film belge singulier.
Sur grand écran, près de chez vous.

Laure Portier, cinéaste, suit son petit frère Arnaud dans une quête de liberté et d'identité sur près de dix ans. Après une enfance turbulente, Arnaud doit faire face à un destin tracé d'avance. Un portrait intime et émouvant d'un esprit en lutte, explorant les liens familiaux et le pouvoir émancipateur du cinéma.
Soy libre
Introduction par Tillo Huygelen
Dans Soy Libre (2021), Laure Portier livre un compte-rendu de la dizaine d’années qu’elle a passé à la recherche d’Arnaud, son frère cadet. Après une jeunesse tumultueuse, Arnaud est parti en quête d’une vie libre. Ce qui le conduira de France jusqu’en Espagne, et qui l’amènera finalement en Amérique du Sud. Soy Libre est le deuxième film de Portier, après Dans l'œil du chien (2019), un court-métrage documentaire qui suit sa grand-mère. Les deux films sont en étroite relation, et vont même jusqu’à s’entrecroiser : Arnaud apparaît dans son premier film pour la première fois devant la caméra. Les deux films reposent sur une histoire familiale profonde et complexe.
En 2012, tout juste diplômée de l’INSAS, Portier va chercher son frère qui venait de sortir de prison, avec la proposition de faire un film ensemble. Portier menait une vie bien différente de celle d’Arnaud. Elle faisait des études d’art, qui l’ont amenée dans un milieu social artistique, alors que son frère a suivi un parcours social bien différent; il est perdu et recherche un nouvel hébergement. Dans une interview à Sabzian, Portier explique que Soy Libre a pour but de créer “un cadre ou un mouvement” pour Arnaud. Elle considère son film comme une manière de “venger” son frère, de lui donner la possibilité de revendiquer un endroit quelque part dans le monde, quelle que soit son origine sociale. Le titre, qui signifie “je suis libre”, veut donc aussi dire “je suis ici” – une quête d’affirmation de soi. “Peut-être que la vision de sa vie lui a donné le courage d’aller vers autre chose. Enfin, j’en suis certaine. Je crois que c’est la seule chose dont parle le film : pouvoir se réinventer soi-même,” dit encore Portier. En ce sens, le film est un espace que se partagent un frère et une sœur : Arnaud tourne également des images lorsqu’il est à l’étranger, et les envoie à sa sœur. L’échange qui en ressort renforce sa quête. Arnaud se filme dans toutes sortes d’endroits, parfois dans des situations précaires : une plage, une manifestation, en train de dormir sur un banc dans un parc la nuit. Ses images sont un signe de vie, autant pour sa sœur que pour lui-même. “Pour ne pas perdre la tête”, il doit toucher le monde et le changer. Il doit sentir qu’il est présent. Il vole, il détruit, il vit dans un monde sans interdit, et il documente tout. Enfin, il fait aussi des dessins qui, dans le film, montrent une autre image de son univers intérieur.
Dans le film, frère et soeur se font face non seulement en tant que membres d’une famille, mais aussi en tant que filmeur et filmé. La question de la responsabilité d’une grande sœur envers son petit frère se reflète dans la tension entre cinéaste documentaire et sujet. Dans Soy Libre, Portier se heurte aux limites du portrait documentaire. Saisir Arnaud en une seule image uniforme et exhaustive se révèlera un vain espoir au long du film. En tant qu’”objet” de documentaire, Arnaud s’échappe constamment de toute représentation définitive. Arnaud entre et sort du cadre en permanence, jouant parfois à un cache-cache filmique avec sa sœur. Plus le film avance, plus elle devient une spectatrice extérieure de son monde. “Est-ce que je gâche ta vie en la filmant ?”, lui demande-t-elle à un moment. Arnaud se laisse littéralement dériver de l’image; la caméra dérange perturbe sa relation à son nouvel environnement, et le cadre filmique n’est plus le bienvenu.
Portier ne se force pas à dissimuler l’artificialité de son film : le jeu est mis en place des deux côtés. “Je crois que j’utilise le mot ‘sincère’ dans le film. Le ‘vrai’ m’importe peu, et encore moins quand il s’agit de cinéma. Le film, c’est l’endroit où l’on se rencontre, un espace commun, un moyen de nous transcender, au-delà de notre propre réflexion sur le monde et notre propre condition.” Au début de Soy Libre, Arnaud dévale la route à toute vitesse en scooter avec sa sœur à l’arrière, caméra à l’épaule. Vitesse qui la met audiblement à rude épreuve. Elle doit continuer à filmer son frère, garder la caméra droite, faire la mise au point. La scène résume bien ce que Soy Libre met en jeu. Tout comme Arnaud se déplace dans l’espace physique, il se déplace dans le cadre filmique, se réinventant constamment et façonnant à volonté la manière dont il apparaît à l’image. Le souhait de Portier n’est pas de comprendre Arnaud. Après tout, la compréhension n’est qu’un autre cadre imposé. “Pour moi, c’est le corps qui doit réagir avant l’esprit : si mon corps l’a compris, le reste suivra.” Soy Libre est une invitation à accompagner Arnaud dans sa quête de liberté, et la tentative d’une sœur de le suivre.
Tillo Huygelen
Cinéaste
Rédacteur et collaborateur artistique Sabzian
Soy libre
Introduction par Tillo Huygelen
Dans Soy Libre (2021), Laure Portier livre un compte-rendu de la dizaine d’années qu’elle a passé à la recherche d’Arnaud, son frère cadet. Après une jeunesse tumultueuse, Arnaud est parti en quête d’une vie libre. Ce qui le conduira de France jusqu’en Espagne, et qui l’amènera finalement en Amérique du Sud. Soy Libre est le deuxième film de Portier, après Dans l'œil du chien (2019), un court-métrage documentaire qui suit sa grand-mère. Les deux films sont en étroite relation, et vont même jusqu’à s’entrecroiser : Arnaud apparaît dans son premier film pour la première fois devant la caméra. Les deux films reposent sur une histoire familiale profonde et complexe.
En 2012, tout juste diplômée de l’INSAS, Portier va chercher son frère qui venait de sortir de prison, avec la proposition de faire un film ensemble. Portier menait une vie bien différente de celle d’Arnaud. Elle faisait des études d’art, qui l’ont amenée dans un milieu social artistique, alors que son frère a suivi un parcours social bien différent; il est perdu et recherche un nouvel hébergement. Dans une interview à Sabzian, Portier explique que Soy Libre a pour but de créer “un cadre ou un mouvement” pour Arnaud. Elle considère son film comme une manière de “venger” son frère, de lui donner la possibilité de revendiquer un endroit quelque part dans le monde, quelle que soit son origine sociale. Le titre, qui signifie “je suis libre”, veut donc aussi dire “je suis ici” – une quête d’affirmation de soi. “Peut-être que la vision de sa vie lui a donné le courage d’aller vers autre chose. Enfin, j’en suis certaine. Je crois que c’est la seule chose dont parle le film : pouvoir se réinventer soi-même,” dit encore Portier. En ce sens, le film est un espace que se partagent un frère et une sœur : Arnaud tourne également des images lorsqu’il est à l’étranger, et les envoie à sa sœur. L’échange qui en ressort renforce sa quête. Arnaud se filme dans toutes sortes d’endroits, parfois dans des situations précaires : une plage, une manifestation, en train de dormir sur un banc dans un parc la nuit. Ses images sont un signe de vie, autant pour sa sœur que pour lui-même. “Pour ne pas perdre la tête”, il doit toucher le monde et le changer. Il doit sentir qu’il est présent. Il vole, il détruit, il vit dans un monde sans interdit, et il documente tout. Enfin, il fait aussi des dessins qui, dans le film, montrent une autre image de son univers intérieur.
Dans le film, frère et soeur se font face non seulement en tant que membres d’une famille, mais aussi en tant que filmeur et filmé. La question de la responsabilité d’une grande sœur envers son petit frère se reflète dans la tension entre cinéaste documentaire et sujet. Dans Soy Libre, Portier se heurte aux limites du portrait documentaire. Saisir Arnaud en une seule image uniforme et exhaustive se révèlera un vain espoir au long du film. En tant qu’”objet” de documentaire, Arnaud s’échappe constamment de toute représentation définitive. Arnaud entre et sort du cadre en permanence, jouant parfois à un cache-cache filmique avec sa sœur. Plus le film avance, plus elle devient une spectatrice extérieure de son monde. “Est-ce que je gâche ta vie en la filmant ?”, lui demande-t-elle à un moment. Arnaud se laisse littéralement dériver de l’image; la caméra dérange perturbe sa relation à son nouvel environnement, et le cadre filmique n’est plus le bienvenu.
Portier ne se force pas à dissimuler l’artificialité de son film : le jeu est mis en place des deux côtés. “Je crois que j’utilise le mot ‘sincère’ dans le film. Le ‘vrai’ m’importe peu, et encore moins quand il s’agit de cinéma. Le film, c’est l’endroit où l’on se rencontre, un espace commun, un moyen de nous transcender, au-delà de notre propre réflexion sur le monde et notre propre condition.” Au début de Soy Libre, Arnaud dévale la route à toute vitesse en scooter avec sa sœur à l’arrière, caméra à l’épaule. Vitesse qui la met audiblement à rude épreuve. Elle doit continuer à filmer son frère, garder la caméra droite, faire la mise au point. La scène résume bien ce que Soy Libre met en jeu. Tout comme Arnaud se déplace dans l’espace physique, il se déplace dans le cadre filmique, se réinventant constamment et façonnant à volonté la manière dont il apparaît à l’image. Le souhait de Portier n’est pas de comprendre Arnaud. Après tout, la compréhension n’est qu’un autre cadre imposé. “Pour moi, c’est le corps qui doit réagir avant l’esprit : si mon corps l’a compris, le reste suivra.” Soy Libre est une invitation à accompagner Arnaud dans sa quête de liberté, et la tentative d’une sœur de le suivre.
Tillo Huygelen
Cinéaste
Rédacteur et collaborateur artistique Sabzian

En 1952 Marie-Louise Chapelle devient la première femme française à grimper un sommet inexploré de l’Himalaya. Des années plus tard, la réalisatrice Ellen Vermeulen suit ses traces. Les ambitions personnelles, les restrictions sociales et la complexité d’être une femme sont au coeur de ce voyage intime à travers des paysages enneigés.
Une femme qui part
Texte d’introduction par Dagmar Teurelincx
Ellen Vermeulen (1982) est réalisatrice, chercheuse et professeure. Son travail se caractérise par un regard critique et une exploration en profondeur des structures sociétales. Avec 9999 (2014), elle a réalisé un documentaire sur l’internement dans la prison de Merksplas qui fut même projeté à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Elle a filmé Catch-19to25 (2016) sur le Reno, bateau d’accueil de réfugiés, inspirée par la théorie des rouages d’Hannah Arendt. Et dans son film sur des enfants avec des besoins éducatifs spécifiques, Inclusief (2018), elle montre même un regard critique sur le système.
Dans son nouveau documentaire, Une femme qui part, Vermeulen se concentre plus que jamais autour d’une quête intime et personnelle. Elle s’intéresse à Marie-Louise Chapelle, première femme a avoir gravi un sommet inexploré de l’Himalaya en 1952. À cet escient, Chapelle menait une double vie. Pendant six mois, elle était une mère et une épouse, et elle passait ensuite le restant de l’année en haute montagne. Dans son journal intime, elle décrit son combat intérieur et les tensions entre ces deux mondes : “Il y a toujours quelque chose qui te manque.” Septante ans plus tard, la réalisatrice refait cette ascension précise de l’Himalaya, guidée par près de vingt ans de recherches sur les archives de Chapelle. Tandis que la voix de Chapelle résonne à travers les lettres et les journaux intimes, Vermeulen formule ses propres pensées et désirs, transformant le film en un dialogue entre les deux femmes. L’exploration du combat intérieur de Chapelle révèle rapidement des parallèles avec la propre vie de Vermeulen. Alors qu’elle dévoile les désirs de Chapelle, elle se confronte à ses propres questionnements existentiels : “Je ne peux plus éluder la question : une vie avec enfant, ou une vie sans ?” L’histoire transforme un portrait biographique en une exploration introspective des choix et des limites qui sont imposés aux femmes.
Dans Une femme qui part, les images d’archives, tournées pendant l’expédition de Chapelle en 1952, se mélangent avec des nouvelles images filmées en grande partie par Vermeulen, assistée de son preneur de son. L'ambiguïté de la source amène le spectateur à se perdre dans des histoires (présumées). Quel récit tirons-nous des archives de Chapelle ? Quelle romance croyons-nous déceler entre la femme et son compagnon de cordée ? Quelles histoires lisons-nous entre les lignes ? Comment évaluer sa relation avec ses enfants, qui étaient privés d’elle la moitié de l’année ? La rencontre de Vermeulen avec Chapelle montre les limites de l’interprétation de la vie des autres. Une femme qui part est une tentative de rapprochement, non seulement dans l’espace, mais surtout dans le temps, avec cette femme qui reste toujours vague sur sa vie personnelle dans ses journaux intimes. Alors qu'ils se traînent dans la neige fondante, le guide de Vermeulen, Boris, remarque que c’est comme s’ils s’enfonçaient dans le temps. Lorsqu’elle approche le sommet, la distance entre Vermeulen et Chapelle s’estompe. “Pour la montagne, nous sommes des contemporaines et nous nous tenons ici ensemble”, dit Vermeulen.
Mais Une femme qui part est plus qu’une quête personnelle. Là où, pour Chapelle, les montagnes ont été un refuge qui lui permettaient de prendre temporairement de la distance avec son couple et avec la vie de famille qui en découle, des années plus tard, elles constituent tout d’abord un moyen de survie pour les 25 porteurs locaux qui guident Vermeulen. Lors d'une pause, ils demandent si Vermeulen ne peut pas leur offrir du travail dans “son pays”. Ce court instant met à nu le malaise tendu de toute l’expédition : un désir personnel pour la montagne se heurte à la réalité des inégalités sociétales qui peuvent limiter de tels désirs. Chapelle fut aussi confrontée à des limites similaires : à 5200m d’altitude, ses compagnons de cordée masculins décident de continuer sans elle. Une femme au sommet réduirait la montagne à une colline, à “une montagne à vaches”.
La montagne, qui semblait si massive de premier abord, dévoile en fin de compte sa volatilité. À cause du recul des glaciers, le parcours emprunté par Chapelle en 1952 ne peut plus être remonté dans son entièreté. Le temps a changé la montagne. Le double rôle de Vermeulen en tant que cinéaste et alpiniste rend l'ascension d'autant plus difficile. Ses images deviennent de plus en plus instables au fur et à mesure que le trek progresse. Vermeulen ne parvient pas à déchiffrer Chapelle.
Petit à petit, Une femme qui part devient un film sur les frontières : entre des époques infranchissables, des désirs contradictoires et des choix impossibles – en particulier pour les femmes. La recherche de Vermeulen des traces laissées par Chapelle, et surtout des non-dits douloureux qu'elles contiennent, se termine sur un ajout dans les archives tout aussi énigmatique.
Dagmar Teurelincx
Spécialiste théâtre et cinéma, écrivaine, responsable de communication Hiros
Une femme qui part
Texte d’introduction par Dagmar Teurelincx
Ellen Vermeulen (1982) est réalisatrice, chercheuse et professeure. Son travail se caractérise par un regard critique et une exploration en profondeur des structures sociétales. Avec 9999 (2014), elle a réalisé un documentaire sur l’internement dans la prison de Merksplas qui fut même projeté à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Elle a filmé Catch-19to25 (2016) sur le Reno, bateau d’accueil de réfugiés, inspirée par la théorie des rouages d’Hannah Arendt. Et dans son film sur des enfants avec des besoins éducatifs spécifiques, Inclusief (2018), elle montre même un regard critique sur le système.
Dans son nouveau documentaire, Une femme qui part, Vermeulen se concentre plus que jamais autour d’une quête intime et personnelle. Elle s’intéresse à Marie-Louise Chapelle, première femme a avoir gravi un sommet inexploré de l’Himalaya en 1952. À cet escient, Chapelle menait une double vie. Pendant six mois, elle était une mère et une épouse, et elle passait ensuite le restant de l’année en haute montagne. Dans son journal intime, elle décrit son combat intérieur et les tensions entre ces deux mondes : “Il y a toujours quelque chose qui te manque.” Septante ans plus tard, la réalisatrice refait cette ascension précise de l’Himalaya, guidée par près de vingt ans de recherches sur les archives de Chapelle. Tandis que la voix de Chapelle résonne à travers les lettres et les journaux intimes, Vermeulen formule ses propres pensées et désirs, transformant le film en un dialogue entre les deux femmes. L’exploration du combat intérieur de Chapelle révèle rapidement des parallèles avec la propre vie de Vermeulen. Alors qu’elle dévoile les désirs de Chapelle, elle se confronte à ses propres questionnements existentiels : “Je ne peux plus éluder la question : une vie avec enfant, ou une vie sans ?” L’histoire transforme un portrait biographique en une exploration introspective des choix et des limites qui sont imposés aux femmes.
Dans Une femme qui part, les images d’archives, tournées pendant l’expédition de Chapelle en 1952, se mélangent avec des nouvelles images filmées en grande partie par Vermeulen, assistée de son preneur de son. L'ambiguïté de la source amène le spectateur à se perdre dans des histoires (présumées). Quel récit tirons-nous des archives de Chapelle ? Quelle romance croyons-nous déceler entre la femme et son compagnon de cordée ? Quelles histoires lisons-nous entre les lignes ? Comment évaluer sa relation avec ses enfants, qui étaient privés d’elle la moitié de l’année ? La rencontre de Vermeulen avec Chapelle montre les limites de l’interprétation de la vie des autres. Une femme qui part est une tentative de rapprochement, non seulement dans l’espace, mais surtout dans le temps, avec cette femme qui reste toujours vague sur sa vie personnelle dans ses journaux intimes. Alors qu'ils se traînent dans la neige fondante, le guide de Vermeulen, Boris, remarque que c’est comme s’ils s’enfonçaient dans le temps. Lorsqu’elle approche le sommet, la distance entre Vermeulen et Chapelle s’estompe. “Pour la montagne, nous sommes des contemporaines et nous nous tenons ici ensemble”, dit Vermeulen.
Mais Une femme qui part est plus qu’une quête personnelle. Là où, pour Chapelle, les montagnes ont été un refuge qui lui permettaient de prendre temporairement de la distance avec son couple et avec la vie de famille qui en découle, des années plus tard, elles constituent tout d’abord un moyen de survie pour les 25 porteurs locaux qui guident Vermeulen. Lors d'une pause, ils demandent si Vermeulen ne peut pas leur offrir du travail dans “son pays”. Ce court instant met à nu le malaise tendu de toute l’expédition : un désir personnel pour la montagne se heurte à la réalité des inégalités sociétales qui peuvent limiter de tels désirs. Chapelle fut aussi confrontée à des limites similaires : à 5200m d’altitude, ses compagnons de cordée masculins décident de continuer sans elle. Une femme au sommet réduirait la montagne à une colline, à “une montagne à vaches”.
La montagne, qui semblait si massive de premier abord, dévoile en fin de compte sa volatilité. À cause du recul des glaciers, le parcours emprunté par Chapelle en 1952 ne peut plus être remonté dans son entièreté. Le temps a changé la montagne. Le double rôle de Vermeulen en tant que cinéaste et alpiniste rend l'ascension d'autant plus difficile. Ses images deviennent de plus en plus instables au fur et à mesure que le trek progresse. Vermeulen ne parvient pas à déchiffrer Chapelle.
Petit à petit, Une femme qui part devient un film sur les frontières : entre des époques infranchissables, des désirs contradictoires et des choix impossibles – en particulier pour les femmes. La recherche de Vermeulen des traces laissées par Chapelle, et surtout des non-dits douloureux qu'elles contiennent, se termine sur un ajout dans les archives tout aussi énigmatique.
Dagmar Teurelincx
Spécialiste théâtre et cinéma, écrivaine, responsable de communication Hiros

Le programme Incendies comprend trois courts-métrages qui traitent du déracinement et de la nostalgie d'un chez soi. À travers la poésie, la chanson et le langage cinématographique, ces films dépeignent l'expérience d'être un nouvel arrivant, d'être en exil ou en fuite, ou simplement de vouloir partir. Comment s'approprier le sentiment d'être quelque part chez soi ? Ces films témoignent d'une recherche fondamentale et universelle d'appartenance.
Branden sera projeté avec Ma'loul Celebrates Its Destruction et/ou Bamssi. Lors de certaines projections, l'un des réalisateurs sera présent pour participer à une discussion après le programme.

Dans les rues étriquées des Marolles, grouillent des gosses. Leur coin de paradis et d’illusions est un terrain vague où un beau jour arrivent des hommes en chapeau mou et d’autres en salopettes qui déploient des papiers… Doucement, la stupeur des gosses se transforme en révolte. Un film sur Bruxelles aux années cinquante, fait avec des gens de la rue.
Le chantier des gosses
Texte d’introduction par Ruben Demasure
Avec Le chantier des gosses (1970), l’autodidacte Jean Harlez (1924) réalise son grand rêve : faire un long-métrage dans le quartier bruxellois des Marolles. Avec les enfants du quartier et une caméra bricolée, Harlez improvise l’histoire d’une bande de gamins des rues qui défendent leur terrain vague contre les géomètres et les entrepreneurs qui veulent y implanter une tour de logements sociaux. La genèse du film fut une bataille aussi spectaculaire qu'éprouvante.
Les études historiques du cinéma belge situent le plus souvent Jean Harlez dans une tradition de “cinéastes du dimanche” obstinés, avec plus de passion que de moyens. Harlez a commencé son film de sa propre initiative en 1954. Poussé par un engagement social critique, il s'est intéressé à la vie quotidienne de la classe ouvrière. Sans intrigue artificielle ni tournage en studio, Harlez a filmé des amateurs locaux dans leur propre environnement. Lorsque des géomètres venaient réellement prendre des mesures pendant un jour de tournage, ils devenaient alors partie intégrante de l’histoire.
Pourtant, il fallut attendre 1970 pour trouver les dernières ressources essentielles à l'achèvement du son du film. “La Belgique préférait faire le plein de visiteurs à son Expo, et ce n'était pas opportun de montrer le revers de la médaille,” déclare Marcelle Dumont, la dialoguiste et épouse de Harlez, dans son discours lors de la projection de gala du film au palais des Congrès. Au milieu des années cinquante, le film montrait un quartier de notre capitale où les habitants devaient se débrouiller sans électricité ni toilettes, avec une seule pompe à eau dans toute la rue.
Après la première, le film n’a pas pu tenter sa chance au cinéma. Après une diffusion à la télévision l’année suivante, l’histoire s’arrête. C'est du moins ce qu'il semblait. Jusqu'à ce que, bien des années plus tard, un employé du Cinéma Nova à Bruxelles rencontre par hasard Jean Harlez, et que la machine se remette en marche. En faisant du Chantier des gosses sa première sortie commerciale, le Nova fut auréolé d’un énorme succès. Le film est resté près de deux mois en salles. Au lancement de la plateforme de distribution Avila, il y a cinq ans, le film devenait disponible en VOD. À l’occasion des cent ans de Jean Harlez, ils ramènent le film en salle.
Mis à part le lieu de tournage, avant de commencer, Harlez n’était sûr que d’une chose : il voulait filmer les enfants en raison de leur sincérité. Le terrain vague qui leur sert de terrain de jeu était le résultat de la récente deuxième Guerre Mondiale. La blessure fut infligée au quartier par une bombe V1 qui, le 8 novembre 1944 (après la Libération), avait pour cible le Palais de Justice. L'impact a provoqué l'effondrement des voûtes du théâtre de Toone. La dynastie des théâtres de marionnettes folkloriques Toone est exactement aussi vieille que la Belgique, et provient de la tradition des pièces de marionnettes satiriques contre les détenteurs du pouvoir. Grâce à Harlez, ce ground zero fut à nouveau le théâtre malicieux d'une bataille contre des promoteurs immobiliers qui tirent fermement les ficelles.
Les enfants sont une représentation idéale des sans-voix. Dans un monde d’adultes, ils gardent un regard émerveillé. Le chantier des gosses commence sur des images d'ensemble de la façade et de l'arrière du Palais de Justice, alors pas encore le chantier éternel de ces quarante dernières années. Sur la balustrade, avec vue sur le quartier des Marolles, un garçon et une fille rentrent dans le cadre en marchant. Ensuite, le spectateur se joint aux enfants. À travers leurs yeux, il se place au point de vue panoramique que les touristes de l’Expo 58 emprunteront exactement au même endroit quelques années plus tard. Cela représente en même temps une résistance à la vision orthodoxe et rationnelle des géomètres et de l'enseignant qui leur apprend à calculer les volumes en classe. Pour les enfants, la rue est l’école d’apprentissage naturelle. Sous le mastodonte de la justice qui surplombe la ville, ils vivent eux-mêmes une injustice et prennent les choses en main. Derrière cette même balustrade, les garçons font pipi sur deux agents de police en contrebas, et tourmentent les figures d’autorité tels Quick et Flupke. À la fin du film, l’image d’ouverture du jeune couple contemplatif revient une dernière fois. Seulement, on ne regarde plus par dessus la balustrade. À la place, c'est une contre-plongée des nouvelles tours d’habitation qui enferment, aveuglantes, la quasi-totalité du cadre. Le petit couple s’en va, chacun de son côté.
Ce texte est une version remaniée d’un texte publié en en 2021 dans Sabzian. La version non abrégée est disponible en ligne.
Ruben Demasure
Coordinateur Art Cinema OFFoff et assistant d’enseignement Cinéma UAntwerpen
Le chantier des gosses
Texte d’introduction par Ruben Demasure
Avec Le chantier des gosses (1970), l’autodidacte Jean Harlez (1924) réalise son grand rêve : faire un long-métrage dans le quartier bruxellois des Marolles. Avec les enfants du quartier et une caméra bricolée, Harlez improvise l’histoire d’une bande de gamins des rues qui défendent leur terrain vague contre les géomètres et les entrepreneurs qui veulent y implanter une tour de logements sociaux. La genèse du film fut une bataille aussi spectaculaire qu'éprouvante.
Les études historiques du cinéma belge situent le plus souvent Jean Harlez dans une tradition de “cinéastes du dimanche” obstinés, avec plus de passion que de moyens. Harlez a commencé son film de sa propre initiative en 1954. Poussé par un engagement social critique, il s'est intéressé à la vie quotidienne de la classe ouvrière. Sans intrigue artificielle ni tournage en studio, Harlez a filmé des amateurs locaux dans leur propre environnement. Lorsque des géomètres venaient réellement prendre des mesures pendant un jour de tournage, ils devenaient alors partie intégrante de l’histoire.
Pourtant, il fallut attendre 1970 pour trouver les dernières ressources essentielles à l'achèvement du son du film. “La Belgique préférait faire le plein de visiteurs à son Expo, et ce n'était pas opportun de montrer le revers de la médaille,” déclare Marcelle Dumont, la dialoguiste et épouse de Harlez, dans son discours lors de la projection de gala du film au palais des Congrès. Au milieu des années cinquante, le film montrait un quartier de notre capitale où les habitants devaient se débrouiller sans électricité ni toilettes, avec une seule pompe à eau dans toute la rue.
Après la première, le film n’a pas pu tenter sa chance au cinéma. Après une diffusion à la télévision l’année suivante, l’histoire s’arrête. C'est du moins ce qu'il semblait. Jusqu'à ce que, bien des années plus tard, un employé du Cinéma Nova à Bruxelles rencontre par hasard Jean Harlez, et que la machine se remette en marche. En faisant du Chantier des gosses sa première sortie commerciale, le Nova fut auréolé d’un énorme succès. Le film est resté près de deux mois en salles. Au lancement de la plateforme de distribution Avila, il y a cinq ans, le film devenait disponible en VOD. À l’occasion des cent ans de Jean Harlez, ils ramènent le film en salle.
Mis à part le lieu de tournage, avant de commencer, Harlez n’était sûr que d’une chose : il voulait filmer les enfants en raison de leur sincérité. Le terrain vague qui leur sert de terrain de jeu était le résultat de la récente deuxième Guerre Mondiale. La blessure fut infligée au quartier par une bombe V1 qui, le 8 novembre 1944 (après la Libération), avait pour cible le Palais de Justice. L'impact a provoqué l'effondrement des voûtes du théâtre de Toone. La dynastie des théâtres de marionnettes folkloriques Toone est exactement aussi vieille que la Belgique, et provient de la tradition des pièces de marionnettes satiriques contre les détenteurs du pouvoir. Grâce à Harlez, ce ground zero fut à nouveau le théâtre malicieux d'une bataille contre des promoteurs immobiliers qui tirent fermement les ficelles.
Les enfants sont une représentation idéale des sans-voix. Dans un monde d’adultes, ils gardent un regard émerveillé. Le chantier des gosses commence sur des images d'ensemble de la façade et de l'arrière du Palais de Justice, alors pas encore le chantier éternel de ces quarante dernières années. Sur la balustrade, avec vue sur le quartier des Marolles, un garçon et une fille rentrent dans le cadre en marchant. Ensuite, le spectateur se joint aux enfants. À travers leurs yeux, il se place au point de vue panoramique que les touristes de l’Expo 58 emprunteront exactement au même endroit quelques années plus tard. Cela représente en même temps une résistance à la vision orthodoxe et rationnelle des géomètres et de l'enseignant qui leur apprend à calculer les volumes en classe. Pour les enfants, la rue est l’école d’apprentissage naturelle. Sous le mastodonte de la justice qui surplombe la ville, ils vivent eux-mêmes une injustice et prennent les choses en main. Derrière cette même balustrade, les garçons font pipi sur deux agents de police en contrebas, et tourmentent les figures d’autorité tels Quick et Flupke. À la fin du film, l’image d’ouverture du jeune couple contemplatif revient une dernière fois. Seulement, on ne regarde plus par dessus la balustrade. À la place, c'est une contre-plongée des nouvelles tours d’habitation qui enferment, aveuglantes, la quasi-totalité du cadre. Le petit couple s’en va, chacun de son côté.
Ce texte est une version remaniée d’un texte publié en en 2021 dans Sabzian. La version non abrégée est disponible en ligne.
Ruben Demasure
Coordinateur Art Cinema OFFoff et assistant d’enseignement Cinéma UAntwerpen
Découvrez sur grand écran du cinéma d'auteur belge stimulant, surprenant et qui donne à réfléchir. Avila, present! propose un programme inédit et diversifié de cinéma belge singulier. Chaque saison, quatre fois par an, Avila parcourt le pays avec un film classique ou contemporain. Regarder des films ensemble et en discuter après, hors des sentiers battus et des frontières linguistiques, voilà ce que le cinéma peut vous apporter.